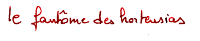Camille de Riveblême à Gaspard Bromzières
Mon cher Gaspard,
Il faut que je vous fasse le récit d’une aventure qui m’est arrivée. Contre toute attente, elle n’a pas pour cadre une île mystérieuse ou quelqu’un des pays lointains qu’il me tarde encore d’aborder, mais un endroit assez bien connu des navigateurs – de tout le monde serait plus exact – pour ce qu’il ne se trouve quasiment qu’à un jet de pierre de Roche de Canon ; je veux parler de l’îlot Piffu. Du diable si j’eusse imaginé m’attarder dans ses parages !
On l’a nommé ainsi, vous le savez, en raison d’une sorte de promontoire qui, vu sous un certain angle, ressemble au nez de Cyrano. Le terme d’îlot est impropre à le caractériser, car il s’agit bel et bien d’une île, suffisamment vaste pour qu’on y ait édifié, outre le fort qui maintenant tombe en ruine, deux grandes maisons qui sont toujours habitées. La première abrite un vieillard excentrique et richissime, le comte de Pomone, la seconde une famille pauvre, qui n’a rien conservé d’un lustre jadis éclatant, sauf cette propriété. Deux femmes y vivent, avec un couple de domestiques qui ont une fille de sept ou huit ans ; l’une d’elles est une tante à moi – peut-être pas exactement une tante, j’entends par ce terme qu’elle et moi nous avons un lien de parenté sans que je sache exactement lequel (on me l’a dit mais cela m’ennuie) ; du reste c’est une habitude établie par ma mère, qui ne s’embarrasse pas de précisions inutiles à ses yeux, de qualifier les membres éloignés de notre famille d’oncle et de tante.
« Puisque vous partez autour du monde, me déclara-t-elle quelques jours avant le départ, arrêtez-vous chez votre tante de l’îlot Piffu ; vous lui apporterez diverses choses que je tiens à lui faire parvenir, ainsi que mon meilleur et plus gracieux souvenir. »
J’eus beau lui objecter qu’elle pouvait faire expédier ce qu’elle voulait par un autre navire, et lui représenter qu’il n’était pas judicieux de me charger d’une besogne importune au responsable d’une importante expédition, elle ne voulut rien entendre ; c’était, disait-elle, l’occasion ou jamais.
Il fallut céder. Les derniers préparatifs achevés, je donnai le signal du départ, ayant embarqué trois lourdes caisses que je devais remettre à ma tante. Je n’ai pas jugé bon de fournir d’explication à cette halte imprévue, me bornant à prendre un air de conspirateur que je jugeais propre à induire chez les officiers le sentiment d’une tâche urgente et secrète, mais il me semble avoir surpris quelques sourires. C’est une vérité que le comportement d’une mère – la mienne s’est mise en peine de me recommander avec force démonstrations aux bons soins de tout ce que notre bâtiment compte de gentilshommes ou de marins expérimentés – atteint quelquefois à la dignité de la fonction qu’occupe son fils.
Nous mouillâmes près de l’îlot ; je descendis du bord par la chaloupe et j’accostai au débarcadère. « Cela vous fera l’expérience d’un premier arrêt sur une île exotique, m’avait encore dit ma mère. Votre tante a du reste quelque chose de suffisamment sauvage pour que vous en tiriez quelque profit. »
Cela me faisait appréhender un peu de rencontrer cette femme, que je n’avais vu qu’une fois, à l’âge de douze ans, et dont je conservais l’image d’une vieille chouette, un visage rond troué de grands yeux noirs qui m’avaient transpercés ; je me souvenais encore de me tenir craintif et pétrifié sous ce regard extralucide.
Nous accostâmes au crépuscule. J’escomptais de revenir à bord sitôt la marchandise déposée. Il en alla tout autrement. Vous saurez la suite demain. Le service m’oblige à vous laisser. Heureux homme, qui abordez, me dites-vous, une île ! Voilà bien des jours que nous n’avons d’autre perspective que l’océan immense et toujours changeant.
Votre dévoué,
C. de Riveblême