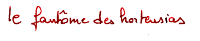Camille de Riveblême à Gaspard Bromzières
Mon cher Gaspard,
Évidemment, c’était une chandelle : ma tante passe toutes ses nuits à compulser des livres mystérieux, m’ont expliqué ses domestiques ; et quelquefois on entend des bruits derrière la porte de sa chambre, qui n’ont rien de commun avec ceux qui sont susceptibles d’émaner de la pièce où vit une paisible octogénaire : des ricanements, des cris, le choc de meubles qu’on renverse, et souvent on a l’impression d’entendre deux voix se répondre l’une à l’autre, bien qu’elle soit seule à l’intérieur. Ne riez pas : si vous l’aviez vu de près, comme je l’ai vue cette nuit-là, après que nous eûmes éveillé la maison, vous ne trouveriez pas que les histoires de sorcières sont des contes à dormir debout, et vous réviseriez votre opinion sur la lanterne qui fait l’éventreur ; contempler le visage de ma tante m’a fait un choc ; plût au ciel qu’il fût demeuré dans l’ombre ! J’avais gardé le souvenir d’une vieille chouette, j’ai découvert une tête de poulet déplumée, et ce regard au fond duquel brûlait une flamme certainement puisée dans un chaudron des enfers.
Il me fallut surmonter ma frayeur pour balbutier quelques politesses d’usage, qui sonnèrent absurdement à cette heure, dans le hall où elle vint nous rejoindre.
« Ma mère vous transmet son meilleur souvenir et vous fait porter ces trois caisses », lui dis-je enfin. Elle n’avait jusqu’alors prononcé aucun mot. « Ouvre celle-ci », déclara-t-elle – sa voix ressemblait au croassement du corbeau – en désignant la moins volumineuse. Je fis signe d’ouvrir la caisse, mais il fallait une pince ou un marteau pour en ôter les clous. Son domestique alla chercher des outils. Outre cet homme et son épouse, qui se partagent les métiers nécessaires au fonctionnement de la maison, il se rencontre dans cet endroit une femme étrange, diaphane, de soixante ans ou plus, dont je ne pus apprendre le nom – elle avait tout à fait l’air d’un fantôme, et, pour autant que je puisse en juger, tout le monde l’ignorait plus ou moins.
La caisse contenait une armure. Une armure de conquistador ou de chevalier – que sais-je, une chose de l’ancien temps, et des armes en pagaille : épée, mousquet, dague, certaines complètement rouillées, d’autres en meilleur état ; je vis qu’elle étaient de grande valeur, à défaut d’être capable d’en estimer le prix. Ma tante laissa échapper un grognement de satisfaction.
« J’ignore où ma mère a récupéré cet attirail, dis-je. Elle ne m’en a jamais parlé. » Ma tante ne prit pas la peine de me répondre. Elle commanda qu’on ouvre les deux autres caisses. L’une était remplie de pièces d’orfèvrerie, l’autre contenait de la soie précieuse et des tapisseries anciennes ; je ne pus réprimer un sursaut en distinguant certaines armoiries brodées ; Gaspard, je n’ose dire lesquelles, mais j’affirme qu’il s’agissait d’étoffes dérobées – l’affaire avait fait suffisamment de bruit quelque temps plus tôt pour que j’en eusse entendu parler. Comme en écho à cette révélation, ma tante déclara :
« Adèle n’avait pas menti. Bonne affaire. Elle a toujours su renifler les poires.
– Ma mère se comporte avec beaucoup de correction, protestai-je, et vos insinuations…
– Camille, va te coucher. »
C’était grotesque. Cette vieille dame qui me traitait comme un enfant semblait s’imaginer que j’allais lui obéir. Mais je ne sais quoi dans le ton dont elle usait me retint de protester. De même, quand elle désigna un de mes hommes de son doigt crochu : « Guillaume, va prévenir Pomone », je faillis lui faire remarquer qu’il ne lui appartenait pas de donner des ordres à l’un de mes braves marins, mais je ne bronchai finalement pas. Comment et d’où connaissait-elle Guillaume ? C’est une question que je tournai et retournai machinalement dans ma tête, une fois couché, sans parvenir à trouver le sommeil, en dépit de cette rude journée. Des chuchotements me parvenaient du jardin, et j’eus le sentiment confus qu’on emportait du matériel par un sentier – plus tard, j’ouvris brusquement les yeux, certain d’avoir entendu un coup de fusil dans le lointain. Mais rien de tel ne se reproduisit et il n’y avait plus de chuchotements. Je me rendormis.
Le soleil était déjà haut quand je sortis de ma chambre. La demeure me parut déserte. J’errai dans les couloirs, jusqu’à tomber sur la porte de l’office. Elle était entrouverte, et j’entendis parler les domestiques de l’autre côté. Quand j’ouvris, ils se turent, mais se levèrent de table et me proposèrent un en-cas, sans répondre aux questions que je formulais sur la maison vide et l’endroit où logeaient mes hommes.
Je n’avais pas dîné la veille et mangeai de bon appétit. C’est là que j’appris ce dont je vous parlais tantôt : comment ma tante se livre très vraisemblablement à des pratiques occultes. J’avais à peine fini mon petit déjeuner qu’une enfant surexcitée entra en trombe en criant : « Il faut partir ! Il faut partir ! » d’un timbre suraigu. Elle attrapa une pomme dans la corbeille et la croqua vigoureusement. Le couple de domestiques ne tarda pas à réagir.
« Dépêchez-vous », marmonna la femme en m’ôtant prestement mon bol, tandis que son mari, bousculant sa chaise, m’attrapait par l’avant-bras et me forçait à me lever.
« Juliette va vous montrer le chemin. Ne tardez plus.
– Mais… mes hommes ?
– Ils vous attendent. »
Je ne trouvais rien à répliquer, et de toute façon, outre le fait qu’il avait de la poigne et me poussait sans ménagement hors de son office, mon ignorance de la situation ne m’offrait guère d’alternative ; somme toute, je n’avais qu’à me laisser conduire.
Il ne s’était pas écoulé plus d’une minute que je courais dans l’herbe, suivant la petite fille qui bondissait devant moi. Il fallut un peu de temps avant que je ne me fasse la réflexion que tout ceci méritait un éclaircissement. Aussi me tournai-je vers elle, toujours courant, et lui demandai : « Que se passe-t-il ?
– Les hommes du comte, répondit l’enfant. Il faut déguerpir. »
A cet instant, un coup de feu retentit et je sentis une balle siffler tout près de mon crâne. Je me pliai en deux. Mon guide cria : « Vite ! Vite ! » Nous gravîmes une côte, dévalâmes des pentes, sautâmes des murets. Une autre fois un coup de feu déchira l’air et la petite, essoufflée, me dit : « Vot’ maternelle a dû leur jouer un tour à sa façon ! » J’étais trop préoccupé par la nécessité de ne pas trébucher pour lui répondre, mais la phrase m’est restée.
Enfin nous touchâmes au but : après avoir franchi péniblement un amas de rochers, je découvris une crique où nous attendait un canot – celui-là même qui nous avait permis d’accoster la veille et qu’on avait transporté là pendant la nuit. Mes hommes me crièrent de me hâter – je m’empressai de leur obéir. Quand je voulus remercier l’enfant pour son aide, je m’aperçus qu’elle avait disparu. Ce n’est qu’après que nous nous fûmes éloignés du rivage que, regardant autour de moi, je demandai : « Que se passe-t-il ? Où est Guillaume ?
– Guillaume est mort », me fit un marin, lugubre.
Croyez-le ou non, je ne pus rien tirer d’autre d’eux, en dépit de ce que je pris soin de leur représenter qu’ils me devaient des explications. A bord du navire, tout le monde fit semblant de rien ; nous appareillâmes sans tarder.
Voulez-vous que je vous dise ? Votre île qui rétrécit ne me dit pas grand-chose qui vaille et je ne partage pas le goût de ses habitants pour le repli sur soi – je n’ai, je dois le dire, pas cherché à éclaircir un mystère qui m’eût obligé à d’éprouvantes introspections comme à la formulation d’hypothèses que je ne désire pas – à quoi bon ? – le sujet m’a tourmenté d’abord, mais, après deux jours de mer, je songeais que l’éloignement de Roche de Canon me serait profitable, que mon navire m’éloignait aussi du besoin de me préoccuper d’affaires importantes – les ports sont faits pour les contenir – ainsi je mesurais dans la forme des nuages, dans le glissement de l’étrave ou dans le parfum de l’océan la saveur de ce mot : partir.
Camille